Histoires humaines au sahara tunisien
Changements des modes de gestion des ressources et conséquences environnementales en milieu aride et saharien
Cas de la Jeffara, des oasis du Nefzaoua et du Sehib, sud de la Tunisie
D'après un article de Mohamed Talbi, Najet Ben-Mansour, Khaled Talbi
Observatoire Intégré des Zones Arides et Désertiques, IRA, Medenine.4119 (Tunisie)
E-mail : Mohamed.Talbi@ira.rnrt.tn
Introduction
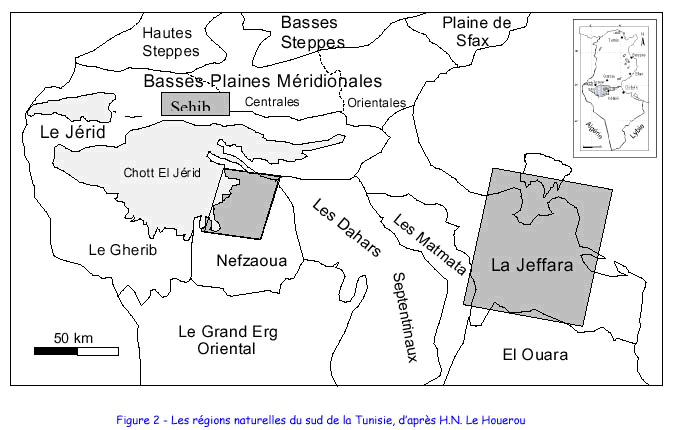 La région d'étude, située dans le Sud de la Tunisie (Figure 2), est sujette à une désertification intense, avec des conséquences désastreuses sur le milieu physique et humain.
La région d'étude, située dans le Sud de la Tunisie (Figure 2), est sujette à une désertification intense, avec des conséquences désastreuses sur le milieu physique et humain.
Dès 1972 en effet, à l'occasion du séminaire de Gabès, les études concernant ce phénomène commencèrent à dresser un constat alarmiste et DREGNE (1977), dans sa carte de l'état de désertification dans le monde, considère la région aride tunisienne comme souffrant d'une désertification sévère, et la seule zone en Afrique classée comme souffrant de désertification très
sévère est située dans le Sud de la Tunisie.
D'autre part, les sources historiques s'accordent à dire que cette région a de tout temps été une zone de peuplement et de passage entre la mer et le continent africain (commerce caravanier), et entre le Nord et l'extrême Sud et l'Orient (MZABI, 1988).
Les mêmes sources rapportent qu'à l'exception de courtes périodes de l'histoire (occupation romaine, invasions hilaliennes), un certain équilibre entre l'homme et son milieu semblait respecté.
Que s'est-il donc passé, pour que le Sud de la Tunisie connaisse une phase de dégradation de l'environnement, jusque là sans précédent ?
S'agit-il d'une crise due à une sécheresse prolongée, comme on a pu le croire au début des années 1970 ? Ou d'un phénomène où l'action anthropique joue le rôle principal ?
Les caractéristiques climatiques (longue saison sèche, déficit hydrique important), édaphiques (sols hérités et fragiles), et floristiques (végétation steppique pauvre), semblent à première vue disposer cette partie du territoire tunisien à la désertification.
Or, d'après la plupart des travaux de recherches (RAPP et al., 1976 ; KHATTELI, 1981 ; FLORET et al., 1982 ; J'GIRIM, 2000), les conditions climatiques et édaphiques n'ont pas connu de grands changements pendant les deux derniers millénaires; il fallait plutôt chercher les principales causes de la dégradation du côté de l'action anthropique, due elle-même aux transformations du mode de vie des populations.
D'autre part, les études sur l'évolution du mode de vie des populations et ses conséquences sur l'utilisation des ressources sont nombreuses (LOUIS, 1979). Les recherches faites sur le sujet, notamment à l'Institut des Régions Arides (OMRANI, 1982 ; BOUHAOUACH, 1983 ; ABAAB, 1981/1984 ; NASR, 1993 ; TALBI, 1983 à 1993 ; MEAT, 1996 ; TALBI, 2000), reconnaissent trois phases clés, à savoir:
- une phase nomade ou d'équilibre, allant du 11e jusqu'à la fin du 19e siècle;
- une phase semi-nomade, ou début de déséquilibre, commençant avec la colonisation française;
- une phase sédentaire ou de rupture totale des règles qui liaient l'homme à son environnement.
Dans ce qui suit, on se propose de rappeler les événements importants de ces différentes périodes et de dégager leurs impacts sur la dynamique environnementale de la région d'étude.
De la gestion collective à l'exploitation individuelle des ressources
Il s'agit de rappeler les grands traits des règles de conduite de l'homme envers son environnement naturel. On parlera alors de la phase nomade, puis coloniale.
La phase nomade
Pendant la période qui s'étendrait depuis l'invasion hilalienne (11e siècle) jusqu'à la fin du 19e siècle, les tribus nomades vivaient sur les parcours localisés entre les régions naturelles des Matmatas et la côte pour les populations de la Jeffara, et ceux situées entre le Dahar, l'erg et Le Gherib pour les nomades du Nefzaoua (Figure 2).
Ces populations pratiquaient un élevage extensif de brebis, de chèvres et de chameaux, suivaient la pluie et se déplaçaient sur l'ensemble du territoire. Elles n'avaient pas pour ainsi dire de territoire fixe (BOUHAOUACHE, 1983).
L'économie régionale était agro-pastorale dans l'ensemble, si on considère que l'activité pastorale des nomades était dominante, mais que son maintien était conditionné par l'activité agricole des sédentaires dans les monts de Matmata et la presqu'île de Kebili et qui fournissaient aux nomades une partie de leurs besoins alimentaires.
A l'intérieur d'une tribu (comme Nefzaoua) ou d'une confédération de tribus (comme Ouerghemma), les rapports entre les différents membres étaient régis par l'esprit de clan, qui consistait en l'adhésion de tous les membres de la tribu aux choix et aux décisions touchant le sort de tout le groupe social (ABAAB, 1984).
Les conséquences sur le milieu, ont été notamment l'absence de sédentarisation en dehors de la presqu'île de Kebili, des Matmatas et Jerba. Aussi la Jeffara, comme le Nefzaoua, étaient des aires de nomadisme pour les tribus, et celles ci avaient une autosubsistance leur assurant une certaine autonomie par rapport au monde extérieur.
Il s'agissait comme le souligne ABAAB (1984), " d'un système autarcique et précaire, mais remarquablement adapté aux exigences et contraintes du milieu aride, à cause de la mobilité constante des tribus, et l'absence d'entraves juridiques ou politiques (frontières) aux déplacements de l'homme et du troupeau" ". Dans pareil système donc, l'utilisation des terres et la recherche de subsistance se faisaient à l'échelle des générations. Là où il ne pleuvait pas beaucoup, une agriculture en sec (céréales) ou une activité pastorale démarrait dans d'autres endroits plus arrosés.
Cette intégration du pâturage et des cultures à l'écologie des terres, a pu se maintenir durant des siècles.
Mais ce système allait être perturbé vers la fin du 19e siècle, avec l'arrivée de la colonisation française dans le Sud tunisien.
L'époque semi-nomade ou coloniale
Cette partie du territoire tunisien fut déclarée " zone militaire " par les autorités coloniales.
Aussi, l'armée du protectorat, pour maintenir les tribus en main, se devait de contrôler leurs déplacements. Cette politique allait déclencher un processus de destruction des systèmes de production et des structures sociales nomades, avec notamment la mise en place de programmes de fixation systématique des populations, la création de nouveaux systèmes de production agricole, et l'introduction de l'échange monétaire.
La sédentarisation devait permettre aux autorités un meilleur contrôle de la population de la région. En vue de cela, l'armée coloniale a commencé par la privatisation des terres (jusque là indivisibles), et par le démantèlement des formes d'appropriation communautaires de la terre et des ressources. Cette politique s'est déroulée en deux étapes (BOUHAOUACHE, 1983).
Tout d'abord il y a eu les opérations de bornage et délimitation de la propriété foncière des fractions de tribus, afin de les amener à se détacher de leur tribu d'origine. Puis il y a eu un processus de lotissement, c'est à dire une séparation individuelle des terres, notamment dans la Jeffara.
Ceci a eu pour conséquences "la perte progressive du contrôle par les nomades, d'un moyen de production fondamental pour la survie de leur mode de vie, à savoir le droit d'usage et a provoqué le démarrage d'un processus de dégradation de celui-ci" (ABAAB, 1984).
Parallèlement, les autorités coloniales ont créé une série de points d'eau, d'agglomérations et de marchés agricoles dans la Jeffara et Le Nefzaoua.
Ces premiers noyaux urbains, dotés d'une infrastructure de base (généralement un puits), et d'un réseau de pistes praticables, vont servir de pôles d'attraction pour les populations nomades.
Pour LOUIS, (1979), cette époque coloniale verra une grande mutation dans la répartition de la population et de l'activité économique, aussi bien dans la Jeffara que dans le Nefzaoua. Pour ABAAB (1984), cette politique "visait l'intégration des populations de la région dans l'aire de domination commerciale de l'économie capitaliste métropolitaine, ainsi que l'ouverture du Sud
de la Tunisie aux denrées coloniales (sucre, thé, café, épices) ; dans le but de transformer progressivement le modèle de consommation des populations locales".
Aussi et devant l'incapacité du milieu de nourrir toute la population, celle-ci va être forcée, face à ce déséquilibre, à pratiquer différentes formes de migrations saisonnières (d'individus ou de groupes), pour la recherche de la nourriture, essentiellement dans les régions oléicoles, dattières et céréalières. Il s'agit du cycle de migration traditionnelle, la « htaya », dans la Jeffara, analysé par BOUHAOUCHE (1983).
Pour conclure, cette phase semi-nomade ou coloniale fut caractérisée par:
- la délimitation des terres collectives, jusque là indivisibles;
- la difficulté de pratiquer la transhumance et le nomadisme;
- le minage du mode de vie nomade, en le privant des ressources naturelles nécessaires, contraignant ainsi les populations nomades à la sédentarisation. Ainsi le cheptel, transhumant moins et pâturant sur des zones limitées, était régulièrement "réduit" par les années de sécheresse. Dans ce contexte et selon BOUHAOUACHE (1983) " à la suite des sécheresses de 1943, 1947 et 1948, plus de la moitié du cheptel a été décimée ".
- la conquête de la Jeffara et du Nefzaoua, par une nouvelle répartition du peuplement et la transformation du paysage de la steppe (création d'oasis, cultures irriguées, dry farming, céréaliculture);
- le développement d'un mode de production semi-nomade attaché à l'appropriation foncière des terres, et à l'exploitation intensive du milieu.
Donc on peut considérer que cette période, bien que mouvementée, a pu maintenir un équilibre des ressources face à l'utilisation par l'homme. Cet équilibre était toutefois précaire, et sera gravement et parfois irrémédiablement entamé par l'homme, qui rentrera en conflit avec son milieu, au cours de l'époque sédentaire (ou actuelle).
Nous nous proposons, dans ce qui suit, d'analyser les transformations survenues dans la Jeffara et le Nefzaoua, et leurs conséquences sur la dynamique environnementale, sur l'état des ressources naturelles et la qualité de vie des populations concernées.
La dynamique du paysage dans la Jeffara
A la date de l'indépendance, en 1956, le Sud de Tunisie hérita d'une situation économique difficile (MZABI, 1988). Ainsi à part le secteur agricole, qui employait plus de la moitié de la population active, il n'existait pratiquement aucune autre activité pouvant constituer une source de revenus "salariés" pour des dizaines de milliers de chômeurs.
Des périodes fortes, ont toutes fois marqué cette époque.
De 1956 à 1970, période allant de l'indépendance au début des années 1970, le milieu, bien que se dégradant de façon lente mais sûre, gardera un semblant d'équilibre. Les raisons de cette évolution doivent être rappelées, vu leur extrême importance :
- il semble qu'entre 1956 et 1962, un phénomène d'abandon quasi-généralisé des terres et de l'occupation pastorale a été causé par l'attrait des agglomérations récemment crées (points d'eau, possibilité d'une activité rémunérée,...), et la migration de milliers d'actifs de la Jeffara et du Nefzaoua vers d'autres régions du pays, et également vers l'étranger ;
- entre 1963 et septembre 1969, la Tunisie a expérimenté une politique de développement " collectiviste " qui, mal appliquée, a fini par ruiner le pays, créant un climat de méfiance qui éloigna les paysans du travail de la terre et de l'activité pastorale.
Le bilan social fut également lourd : la paysannerie est ruinée ; l'exode vers les villes s'est intensifié, et les chantiers étatiques de lutte contre le chômage étaient incapables de répondre à toutes les demandes d'emploi.
Les conséquences, sur le milieu physique, ont été de diverses sortes, allant de l'abandon des plantations qui risquaient " la collectivisation ", à la baisse de la pression sur le milieu à cause de la régression de la charge animale (la moitié du cheptel ayant été abattu ou vendu à des prix dérisoires entre 1966 et 1969 (TALBI, 1993).
- L'abandon de l'expérience coopérative en 1969, va relancer deux activités très " désertifiantes ". Il s'agit du retour en force de l'élevage, et du développement du défrichement des terres avec des moyens mécaniques et une intensité inconnues jusque là, notamment grâce aux transferts financiers de milliers de travailleurs originaires de la région, et vivant à l'étranger.
- De 1970 à nos jours, et après une courte période d'attente, ayant succédé à l'abandon du choix coopératif et le retour à la libéralisation de l'économie, l'argent provenant de l'extérieur jouera un rôle de premier ordre dans la mutation très rapide qu'a connu la Jeffara dès les années 1970 (NASR, 1993).
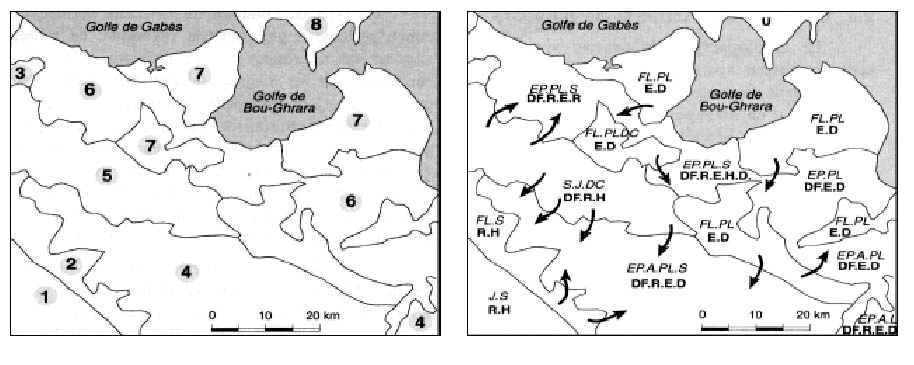
|
Figure 4 - Les grandes unités
paysagères dans la Jeffara 1 : montagne, 2 : zone de piedmont, 3 : oasis, 4 : plaines sableuses, 5 : plateau encroûté de Médenine, 6 : milieu gypseux salé, 7 : domaine des olivettes, 8 : île de Jerba |
Figure 5 - Les causes de la dégradation
et leurs conséquences sur le milieu 1-Causes de dégradation : EP - attribution des terres collectives, A - extension de l'arboriculture, PL - utilisation d'outils non appropriés, FL - fréquence des labours (dray farming) , S - surpâturage, J -Faible entretien des ouvrages, DC - destruction de la croûte calcaire, U -Urbanisation, 2- Conséquences sur le milieu : DF - défrichement des parcours, R -régression du couvert végétal naturel, E -érosion éolienne, H - érosion hydrique, D -formation des dunes mobiles. |
Ce pouvoir financier se concentrera essentiellement sur quatre secteurs : la sédentarisation, l'appropriation et la mise en culture de nouvelles terres, le retour à l'élevage, et la généralisation de la mécanisation.
Mais si ces quatre secteurs cités plus haut témoignent d'un retour à une dynamique économique et agricole régionale, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent les facteurs clefs de la
dégradation du milieu dans les grandes unités paysagères de la Jeffara (Figures 4 et 5).
La sédentarisation
Encouragée par les autorités coloniales puis par celles de l'indépendance, la sédentarisation ne prendra de l'importance qu'avec l'apport monétaire provenant des travailleurs de la région, émigrés à l'étranger.
En effet, " le premier réflexe " de l'émigré était de se construire une maison en dur, là où se trouve sa terre.
Le résultat est un habitat rural isolé mais dense qui de nos jours, caractérise la Jeffara par rapport à toute autre région aride du pays. Cet habitat rural en dur, aura pour conséquence directe le maintien d'une présence humaine et animale permanente sur l'ensemble du territoire étudié; ce qui se traduira par une pression importante et continue sur le milieu. De ce fait, ce type de " sédentarisation rurale " est plus préjudiciable au milieu que l'urbanisation (qui transforme un espace moins important).
L'appropriation et la mise en culture de nouvelles terres
Cette tendance s'est beaucoup accélérée au début des années 1970 ; principalement à cause du début d'épuration du statut foncier des terres collectives, et du pouvoir d'achat croissant des travailleurs émigrés à l'étranger.
En effet, le " second réflexe " de l'émigré, après la construction d'une maison en dur, est d'accroître son patrimoine foncier en achetant ou en louant de nouvelles terres, pour y planter des oliviers et pratiquer la céréaliculture.
Ce type de culture rendra le sol mobile en surface, et détruira le couvert végétal, le privant en outre de sa réserve d'humus. Ainsi, dans les endroits les plus exposés au vent, les accumulations dunaires se forment rapidement à partir de ce matériel érodé.
La mécanisation effrénée
Au début des années 1970, après l'abandon de l'expérience coopérative et le retour au travail de la terre, l'utilisation du tracteur s'était généralisée.
Le remplacement de l'araire ou la charrue à soc, par la charrue à poly-disques entraînera une érosion hydrique et éolienne importante (avec une perte en sol allant de 50 à 250 tonnes/ha/an, selon les travaux de l'Institut des Régions Arides), et conduisant rapidement à un paysage désertifié.
KHATTELI (1981) et NOVIKOFF (1983), démontrent que la capacité journalière de labour d'un tracteur est quarante fois supérieure à celle d'un animal. Par conséquent, cent tracteurs peuvent faire un mal irréparable à 300 000 hectares en une seule campagne de labour dans le cas d'une année pluvieuse.
D'autre part, les études d'inventaire et de suivi de la désertification notamment par télédétection, effectuées par l'Institut des Régions Arides depuis 1972, rendent bien compte de l'effet dévastateur des outils de travail du sol et notamment la charrue à disques (TALBI, 1993).
Donc, bilan très négatif de la mécanisation qui, utilisant des outils mal adaptés aux conditions climatiques et édaphiques, a engendré en quelques décennies, des dégâts supérieurs à ceux connus par la région pendant des siècles entiers.
L'élevage, les terrains de parcours
Le développement du courant migratoire, la sédentarisation systématique des populations et l'extension de la mécanisation ont entraîné le développement d'un élevage de type nouveau, semi-extensif et " sédentaire".
En effet, la privatisation des terres collectives et l'extension des zones céréalières, suite à l'emploi des tracteurs, ont sensiblement réduit les superficies jusque là réservées au parcours. En outre, la disparition de la transhumance dans la région a entraîné l'éclatement des grands troupeaux en troupeaux de petite taille (de 20 à 50 têtes).
Auparavant des bergers collectifs, qui rassemblent les animaux de différents propriétaires, pratiquaient une petite transhumance, ce qui permettait d'exploiter saisonnièrement les parcours encore collectifs relativement proches des lieux de sédentarisation (un rayon de 15 à 25 km). Ce type de conduite du troupeau permettait, en année agricole à pluviométrie favorable, au milieu végétal de se régénérer. La pression n'est pas continuelle sur les mêmes endroits et le bilan n'était pas négatif dans son ensemble.
Les troupeaux " sédentaires " (2 à 20 têtes) issus de l'éclatement des troupeaux collectifs entraîneront, quant à eux, les conséquences les plus graves sur les ressources du milieu.
Gardés en effet par les vieillards, les femmes ou les jeunes enfants, ces troupeaux pâturent toujours et continuellement les mêmes endroits, autour des habitations, empêchent ainsi toute régénération du couvert végétal.
Le résultat est soit une auréole de dégradation et la disparition de toute végétation (croûte mise à nu dans le cas des formations cohérentes), soit le développement très rapide d'espèces végétales de substitution, à faible utilité pastorale (comme Astragalus armatus sur les croûtes, et Aristida pungens sur les sols sableux).
Ce type de paysage caractérise les zones limitrophes de l'habitat rural le plus dense où les troupeaux sédentaires sont les plus nombreux, et notamment le plateau de Médenine.
L'étude de la dynamique du milieu dans la Jeffara entre 1972 et 1985, traduira sur le terrain les conséquences du passage de l'usage collectif à l'usage individuel des ressources naturelles.
Pour avoir une idée sur les tendances de la dynamique du milieu, la solution a consisté à analyser, synthétiser et simplifier les documents originaux, en groupant les classes présentant peu d'intérêt pour l'étude, pour ne garder que les thèmes principaux.
Aussi, nous avons opéré un groupage des classes, les ramenant à 5 seulement par date (1972 et 1985), ce qui nous proposait 25 possibilités de dynamique.
Il est entendu que ce groupage a été fait après l'examen visuel des deux classifications en 12 classes de 1972 et 1985, qui a montré que la dynamique est la plus forte dans la plaine sableuse et le domaine des olivettes.
En conclusion
Le facteur anthropique reste le facteur le plus important; les contraintes physiques et climatiques ne constituent, dans la plupart des cas, que des facteurs favorables.
Aussi, le paysan, libéré des règles de la collectivité, où la gestion de l'espace vécu n'est pas une intervention indépendante mais un élément indissociable de l'aménagement régional, est désormais livré à lui-même, et devient seul maître de son lopin de terre (HAMZA, 1986).
Pour marquer son appropriation de la terre, le paysan se livrera alors automatiquement à l'arboriculture, soit en travaillant lui-même, soit en associant une autre personne, par un contrat de " Mougharssa ".
La conservation du patrimoine eau et sol n'étant plus l'affaire de tous, le nouveau propriétaire ou son " Mougharssi " utilisera (l'argent aidant), des moyens techniques inconnus jusque là (tracteurs notamment), pour défricher, planter et entretenir, par des labours fréquents, les nouvelles plantations.
A partir de 1972, et compte tenu des zones déjà désertifiées et transformées en dunes mobiles, de nouvelles terres jusque là intactes et réservées au parcours vont subir une pression qui sera en relation avec la cadence d'attribution des terres collectives.
Ainsi a été brossée la situation dans la Jeffara, mais qu'en est -il du Nefzaoua ?
La dynamique du paysage dans le Nefzaoua
Comme dans le cas de la Jeffara, le facteur anthropique est ici aussi l'acteur principal de la dynamique environnementale. Les manifestations se caractérisent par le développement sans précédent des périmètres irrigués, la réduction des zones destinées au parcours et la salinisation des terres.
Le Nefzaoua se distingue de la Jeffara par des conditions climatiques et édaphiques plus difficiles. Le climat se caractérise, en effet par une pluviométrie moyenne annuelle inférieure à 100 mm, un vent dominant de secteur Est souvent violent, de fortes chaleurs estivales, une ETP moyenne de 1600mm/an, entraînant un déficit hydrique aigu et quasi-permanent.
Toutefois, le climat de la région est très favorable à la culture des dattes, surtout de la variété Deglet- Nour, sous réserve d'irrigation abondante.
Les sols arables sont rares et se caractérisent par un apport artificiel constant de matières organiques et d'éléments minéraux qui peuvent représenter jusqu'à 40 cm d'épaisseur. Ces sols sont très sensibles à la salinisation. Faute d'un mauvais drainage, ils sont vite engorgés d'eau, ce qui provoque une concentration des sels en surface.
Ainsi à Kébili, les eaux de drainage (estimées à 981 L/S en hiver) ont une salinité comprise entre 2,6 et 8,8g /L. En été, les quantités d'eau de drainage sont moins importantes (932L/S) et plus chargées (2,9 à 12,3g/L), mais peuvent être aussi valorisées sous certaines conditions (CRDA 1997).
Après ce bref aperçu sur les conditions physiques, analysons les grandes tendances de la dynamique environnementale dans le Nefzaoua. On dégagera une première période allant du début du siècle à 1985, et une seconde s'étalant de 1985 à nos jours.
-La période entre 1905 et 1985
Une première analyse des cartes d'état major du début du siècle (1905), montre la région du Nefzaoua méridional comme un paysage très peu humanisé, avec une prépondérance des chotts et des accumulations dunaires. Aussi hormis Jemna, Douz et El Goléa, Nouail, Zarsine et Blidet, les oasis ne constituent (à une exception prés au sud de Oued El Melah), que des petits îlots de palmiers isolés, crées autour des sources ; jouant ainsi le rôle de halte-bivouac sur la route des caravanes.
Toutefois, la situation va rapidement évoluer vers la moitié des années 1940, avec la sédentarisation de plus en plus fréquente des nomades et l'introduction de nouvelles technologies de forage. Ce qui aura pour conséquences directes la multiplication de nouvelles oasis autour de ces noyaux. Il est toutefois important de noter à cet égard que la création des forages s'est toujours faite, pendant toute cette période, sous la direction et le contrôle de l'Etat.
La période des années 1960 fut marquée, comme pour la Jeffara, par l'avènement puis l'abandon de l'expérience coopérative, ainsi que par l'émigration vers l'Europe de milliers d'actifs dans les oasis, " Khammassa " (les khamès), qui contribuaient à l'entretien des périmètres irrigués.
Malgré la continuation des efforts de forage dans tout le Nefzaoua, la période du début des années 1970 n'a pas vu une grande transformation dans l'occupation des sols.
Les causes principales ayant été l'abandon quasi généralisée des parcelles pendant la période collectiviste, doublée au cours de la même période par le départ à l'étranger d'une grande partie de la main d'oeuvre oasienne.
Par contre, une analyse comparative de la situation entre 1971, matérialisée par les photos aériennes de 1971, la carte topographique au 1/200.000e, et l'image du satellite Landsat TM de 1985, illustre une reprise nette des créations oasiennes autour des forages dans la zone du Nefzaoua méridional.
Cette reprise serait due notamment à l'intensification du Programme du Développement Régional (PDR), le début des opérations de privatisation des terres collectives, mais surtout à la promotion de Kébili au rang de Gouvernorat et enfin aux transferts financiers des travailleurs de la région à l'étranger.
Toutefois c'est la période de la moitié des années 1980 qui marquera les plus grandes dynamiques dans le paysage du Nefzaoua méridional, notamment à cause de la "ruée" vers la réalisation de forages à bras.
-Entre 1985 et 1996
La zone du Nefzaoua méridional connaît depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990, une dynamique importante, liée essentiellement à la multiplication rapide des forages individuels et la création de nouveaux périmètres irrigués autour de ces ouvrages.
En effet, l'image Landsat TM de 1996, que ce soit en lecture directe (image en fausses couleurs) ou après traitement (Indice de végétation, addition et soustraction de canaux, classification, ...), montre une extension sans précédent des nouveaux périmètres irrigués réalisés entre 1985 et 1996, notamment à partir de l'oued El-Melah jusqu'à Douz ; le plus souvent à l'Ouest de la route reliant Kebili à Douz.
La plus grande concentration des créations individuelles se situe toutefois aux environs Nord et Ouest de Douz et d'El Goléa, à l'Ouest de Jemna, autour de Blidet, B'chelli et Zarsine.
L'analyse de la situation topographique des nouvelles créations privées montre dans la plupart des cas, sinon dans leur totalité, que ces créations nouvelles ont été faites sur des terrains bas et mal drainés, donc facilement engorgeables.
La situation est d'autant plus préoccupante que les sondages privés sont de type artésien, donc fonctionnant sans arrêt, déversant l'excès d'eau (Màa Zayid ) à l'extérieur du périmètre, vers les zones basses aux alentours immédiats du périmètre irrigué.
Avec la multiplication rapide de ces sondages (aux alentours de 1700 actuellement), on assiste à une extension géographique sans précédent des zones humides qui constituent désormais des unités "homogènes" occupant de grandes superficies.
L'analyse de l'image satellitale de 1996 montre, à coté des périmètres irrigués à partir des sondages (reconnaissables à leur signature spectrale caractéristique), une végétation galerie (notamment des roseaux) poussant le long du cheminement des eaux vers les Sebkhas, et colonisant de plus en plus de superficies, ainsi que de nombreux " lacs " résultant des énormes quantités d'eau artésienne provenant des centaines de sondages à bras.
Conclusion:
Dans le Nefzaoua méridional, et à cause de ces énormes quantités d'eau déversées puis évaporées, on assiste à la réaction en chaîne suivante :
- les sondages à bras, vu leur nombre et leur artésianisme, contribuent à une surexploitation sans précédant des ressources et au rabattement rapide de la nappe ;
- le rabattement de la nappe amène de plus en plus le recours au pompage, qui sera quasi généralisé vers l'an 2010, si la situation actuelle continue ;
- l'excès d'eau d'irrigation, conjugué avec l'absence de drainage, contribue à une salinisation rapide des sols dans les périmètres, et par conséquent à une dégradation de leur capacité productive, qui va se réduisant d'année en année, jusqu'à leur stérilisation, avec toutes les conséquences prévisibles sur la vie de la population ;
- une conséquence observable depuis le début du rabattement de la nappe est le dépérissement progressif d'un élément du patrimoine paysager, qui a fait de tous temps l'originalité et la beauté du Nefzaoua, à savoir les bouquets de palmiers appelés " d'zira ", qui, faute d'eau, meurent les unes après les autres ; ce qui réduira l'attrait pour ces zones et ne manquera pas par conséquent d'affecter l'activité touristique régionale.
Notons pour conclure que dans le Nefzaoua méridional, l'extension oasienne récente, faite la plupart du temps de façon non contrôlée, fait subir aux ressources en eau et en sol, ainsi qu'au paysage, des transformations profondes et irréversibles.
La situation actuelle est caractérisée par une concentration des hommes et des activités sur un milieu fragile.
Pour prévenir le risque d'arriver à la limite absolue des ressources essentielles, il est nécessaire de poser avec acuité le problème de régulation et d'arbitrage. Il est également urgent de repérer les bases dynamiques d'un environnement viable, susceptible de générer un développement socio-économique durable, suffisamment fort pour répondre aux besoins croissants de la population actuelle, sans fragiliser ni hypothéquer l'avenir. Le développement durable est-il perdu pour toujours ? C'est ce que nous nous proposons de traiter dans ce qui suit, notamment en réfléchissant sur les piliers de ce développement durable ; et ce à partir de l'étude de cas de la région du Séhib, où un système de gestion des ressources, basé sur le savoir local, a fait
ses preuves depuis des siècles et semble être l'un des meilleurs modes, efficace et raisonnable, de gestion des ressources, et mérite d'être compris, réhabilité et réinventé.
Pour un dévelppement durable
Malgré la progression rapide de la modernisation et des changements économiques, il subsiste encore quelques systèmes de gestion et de savoir agricoles et pastoraux traditionnels, bien adaptés à leur environnement, ils s'appuient sur l'utilisation des ressources locales, et sont appliqués à petite échelle et de façon décentralisée et sont enclins à préserver les ressources naturelles.
Dans ce contexte, malgré une aridité soutenue et une activité anthropique datant depuis l'époque romaine, la région du SEHIB dans les Basses Plaines Méridionales (Figure 2), semble en effet constituer une exception, pour avoir gardé un équilibre qui contraste avec son environnement immédiat.
Ce système présente en effet des leçons sans précédant en terme d'adaptation de l'Homme à son milieu précaire. Il se réfère au bagage que les femmes et les hommes de la région ont accumulé sur leur environnement et de quelle façon il influe sur leur quotidien. Ces connaissances locales, qu'elles se présentent sous la forme variétés culturales, de techniques de rotation, de pratiques ou de technologies, sont fondées sur l'expérience et souvent héritées des générations passées et elles ont été testées au fil des siècles et le sont encore, pour être adaptées aux conditions, aux besoins et aux impératifs locaux.
Une réponse, maintenant largement acceptée, est que ce sont ces stratégies paysannes qui doivent servir de guide dans l'élaboration des projets de recherche et de développement en milieu rural.
Pressés par le but de dévoiler les sujets mal connus ou peu étudiés de la région aride, d'éclairer les instances de décision et du développement sur la nécessité de réhabiliter et d'intégrer ces connaissances locales au processus de la recherche et du développement, on essayera, d'après l'étude de la région de Séhib, de mettre en relief les différents principes qui ont instauré cette stratégie d'adaptation aux contraintes du milieu (édifiée depuis plus de 3000 ans), qui se base notamment sur la valorisation d'un savoir-faire ingénieux et une discipline collective adaptées aux conditions des lieux, exploitant les ressources de la manière la plus raisonnée et dans esprit de durabilité, comme s'il s'agissait d'un patrimoine plutôt que d'une ressource.
Les principes directeurs de gestion de la ressource "patrimoine"
Les entretiens avec diverses générations de la population détentrice du savoir local, les tournées de reconnaissance de terrain, la compilation de la documentation existante, l'exploitation des documents aériens et satellitaux, nous permet de brosser un diagnostic des principes lignes directrices du savoir local ; ainsi que des moyens mis en oeuvre pour arriver à une gestion optimale des ressources, dans le cadre d'une approche holistique du développement durable.
Il est toutefois utile de signaler que ce travail ne constitue qu'une ébauche d'une recherche plus approfondie, prévue dans le cadre des activités du programme national : " Observatoire Intégré des Zones Arides et Désertiques ", et qui permettra de mieux prendre en compte les composantes et les interactions du système des connaissances locales et leur intégration dans le processus de recherche et de développement.
Ainsi la devise stratégique gouvernant le savoir local consiste à considérer la ressource comme un patrimoine stratégique à gérer avec soin, et non comme un produit à exploiter sans modération. Aussi cette gestion doit-elle se faire tenant compte des besoins actuels, mais également de ceux des générations futures.
Ce type de rapport très affectif entre l'homme et son patrimoine nécessite une discipline individuelle et collective sans faille, mettant en exergue l'intérêt du groupe social, mais également toutes les interactions liant les différentes composantes du milieu, dans le cadre d'une approche holistique.
Cette devise stratégique de la ressource " patrimoine ", trouve son application sur le terrain grâce à un ensemble de règles de conduites prenant en compte aussi bien les conditions climatiques et édaphiques, que les notions de temps, de rareté et d'abondance.
L'expérience locale, acquise et transmise depuis des siècles, repose sur le principe suivant: ne jamais essayer de forcer le milieu ou contrôler la nature, mais s'y adapter.
Partant de cela, l'expérience locale a institué une série de règles de conduite guidant les relations régissant l'homme avec sa ressource patrimoine, dont notamment :
-la gestion de la rareté, qui consiste à bien connaître les limites au-delà desquelles les ressources ne doivent pas être sollicitées, pour ne pas risquer leur dégradation;
-la gestion du temps est en corrélation directe avec ce qui précède, puisque c'est le facteur temps qui détermine la dégradation de la ressource.
Aussi la gestion du facteur temps a donné naissance à la notion de mobilité comme stratégie d'adaptation à la rareté des ressources.
-la gestion des risques quant à elle, est une adaptation aux aléas climatiques. Elle se concrétise sur le terrain par la diversification des activités (agricole, pastorale, commerciale, ...) ou la division des risques d'une mono activité (céréaliculture, ...) en la pratiquant dans des zones bioclimatiques différentes;
-enfin par gestion de l'abondance, on entend tirer partie des rares années favorables ou exceptionnelles. Cela consiste notamment à garder une partie de la bonne récolte en prévision des années difficiles (qui reviennent plus souvent que les campagnes favorables), à ne vendre que le strict nécessaire et juste ce qu'il faut pour diversifier la production : vendre du blé pour augmenter le troupeau ou se construire un nouveau "majen" pour mieux récolter les eaux de pluies.
Conclusion
Les exemples que nous venons de voir dans la Jeffara et le Nefzaoua, se conjuguent donc pour générer une dynamique du milieu allant dans le sens de la dégradation.
Cette dynamique de dégradation est définie comme " un processus d'attaque du sol par différents facteurs dont la conjugaison et la permanence rendent un territoire fertile à l'origine en une terre stérile, inapte à toute production et susceptible d'interférer sur les zones limitrophes en les stérilisant ". Mais quelle que soit la définition qu'on retient, c'est généralement l'Homme qui, en détruisant l'équilibre entre lui et son milieu, crée la dégradation. Les contraintes physiques et climatiques constituent, dans la plupart des cas, que des facteurs favorables.
Et si du point de vue technique, la lutte contre la dégradation semblait simple et possible ; les résultats décevants partout dans le monde, montrent la nécessité d'une approche alternative du problème et demande néanmoins une discipline sans faille de la part des habitants et des efforts de longue haleine de la part des autorités.
A cet égard, nous avons brossé rapidement, à travers l'exemple du Séhib, la relation entre l'homme et les ressources et l'importance de la sauvegarde, la réhabilitation du savoir local.
Ainsi, plus d'une leçon peuvent être conclues :
-alors que la science moderne et les efforts de développement ont comme objectif de contrôler la nature, les savoir local au contraire s'y adapte. Les sociétés détentrices de ce savoir acquièrent de ce fait une connaissance intime et une bonne compréhension de leur propre environnement qu'il faudra mieux appréhender.
-le savoir des populations rurales connaît néanmoins des limitations. Il est en effet souvent local, empirique, concret mais largement intuitif. Il constitue donc un système presque fermé qui dépend de ce que le paysan peut observer directement. Ce dernier n'a pas accès au corpus des connaissances théoriques, aux techniques spécialisées et ne peut donc de lui-même accéder entièrement aux ressources extérieures ;
-l'échec rencontré dans plusieurs projets de développement rural, soulève la question de la faiblesse de la recherche dans l'élaboration et la diffusion de technologies susceptibles d'être largement adoptées par la population locale, dotée de peu de ressources, dans un environnement moins favorisé ;
-l'objectif de la recherche et du développement devrait par conséquent faciliter la symbiose entre le savoir local et les innovations de la science officielle ;
-la meilleure façon d'atteindre cet objectif est de promouvoir la participation complète des paysans dans le développement des technologies appropriées. Cette participation est un pré-requis pour l'adaptation des technologies exogènes à l'environnement social, physique et écologique de la région ciblée.
Mais cette participation est tout aussi essentielle pour assurer un retour nécessaire de l'information vers les scientifiques. La participation des paysans sera en quelque sorte un facteur correctif des erreurs d'appréciation que des développeurs ou chercheurs appartenant à la science officielle commettent, parce qu'ils n'adoptent pas une vision suffisamment holistique des systèmes de productions agricoles (Figure 10).
Finalement, on peut avancer qu'au moment où la transformation inévitable des moyens de production occasionne des changements partout dans le monde, il semble que les méthodes traditionnelles de culture et de gestion ont des raisons d'être à la fois humaines et écologiques durables.
D'autre part, l'étude approfondie des agro-écosystèmes traditionnels met au point des agro-écosystèmes nouveaux, améliorés pour remédier aux nombreux problèmes dont souffre l'approche " moderne ".
Les connaissances locales sont l'aboutissement de longs siècles d'évolution culturelle et biologique ; ils sont le fruit de l'expérience de l'interaction avec l'environnement accumulée
par des paysans qui n'avaient pas accès à des intrants extérieurs, à des capitaux ou à des connaissances scientifiques. Se fondant sur leur expérience, ces agriculteurs ont mis au point des agro-systèmes durables en utilisant les ressources disponibles localement et l'énergie humaine et animale.
La sédentarisation des nomades dans le sud tunisien : comportements énergétiques et désertification
Cahiers "Sécheresse", Vol. 7, numéro 1, page 17-24, Mars 1996 Laurent Auclair (Orstom, BP434, 1004 Tunis-El Menzah, Tunisie) Mohamed Sgahier Zaafouri (Institut des régions arides, 6051 Nahal-Gabès,Tunisie )
Depuis l’indépendance, l’État tunisien a mis en œuvre une politique volontariste de création de périmètres irrigués et de sédentarisation des nomades dans le sud du pays.Cette politique a eu pour conséquence une transformation importante des relations de la population avec l’espace et les ressources naturelles. Nous proposons ici de retracer cette évolution dans une oasis du Nefzaoua à travers l’étude des filières et des comportements énergétiques.
La naissance d'une oasis, El Faouar
L’oasis d’El Faouar est située à la limite méridionale du Nefzaoua (figure 2), au contact des dépressions gypso-salées du chott El Jerid et des sables du Grand Erg Oriental. L’ambiance saharienne est caractérisée par des précipitations faibles et irrégulières (inférieures à 100mm), de fortes amplitudes thermiques et la fréquence des vents du sud et de l’ouest (le sirocco souffle près de 30jours par an).
L’histoire de l’oasis est celle de la sédentarisation des tribus Ghrib et Essabria dont l’aire de transhumance s’étendait au sud du chott, jusqu’aux confins algériens et libyens. El Faouar n’était, il y a quelques décennies, qu’un îlot de palmiers (zira) regroupés autour d’une petite source artésienne, un lieu d’hivernage pour quelques familles nomades. Jusqu’aux premières années de l’indépendance, les Ghrib étaient considérés comme d’irréductibles chameliers, les derniers «vrais nomades du sud tunisien»; les autres groupes étaient alors qualifiés de semi-nomades ou de sédentaires-transhumants, tels les Essabria qui disposaient d’un point de station dans l’oasis voisine de Sabria. «Caravaniers de profession, réputés pour leur sobriété de vie, longtemps sous la tutuelle des Chaambas algériens, les Ghrib tiraient jadis leur principal revenu des convois caravaniers. Ils nomadisaient encore récemment, huit à neuf mois par an, ne se regroupant autour de l’oasis de Jarcine, où ils ont creusé des puits, que de novembre à janvier. À la différence des autres tribus, ils furent longtemps sans avoir de village comme point de station. Mais dès le forage du puits artésien d’El Faouar, ils viendront y faire régulièrement aiguade et y fixeront leur camp d’hiver.»
Dès 1949 en effet, un premier forage, puis un poste frontière et une école sont créés par l’administration française. Mais il faut attendre la fin des années '60 pour que des familles nomades viennent construire et s’installer à El Faouar. Le processus de sédentarisation va s’accélérer brutalement au cours des deux décennies suivantes, avec un pic de fixation autour des années 1975-1980. Dans le cadre du Plan directeur des eaux du sud, la création d’un forage supplémentaire va permettre de lotir 134 hectares de palmeraie en 1982. La population d’El Faouar décuple entre 1970 (environ 1.000 habitants dont de nombreux transhumants), et 1994 (environ 10.000). Outre l’importance du mouvement de sédentarisation qui explique cette croissance exceptionnelle (un taux de croissance annuel de près de 10%), la population est caractérisée par un fort dynamisme démographique. La fécondité y est largement supérieure à la moyenne nationale: 47% de la population est âgée de moins de 15 ans.
La trame urbaine d’El Faouar apparaît comme le résultat d’une construction spontanée caractéristique de la sédentarisation de populations nomades: dispersion des maisons à cour intérieure (haouch) juxtaposition des quartiers d’habitation selon l’origine tribale. Promu chef-lieu de délégation en 1984, El Faouar dispose aujourd’hui de nombreux services administratifs, de deux écoles et d’un collège secondaire. L’oasis est reliée à Douz et à bir Redjem Maatoug par une route goudronnée.
Ville nouvelle habitée par de nouveaux oasiens, El Faouar est le fruit de la politique coloniale de sédentarisation relayée par l’action volontaire de l’État tunisien. L’agriculture irriguée y représente, en dépit de l’exiguïté des surfaces disponibles (en moyenne un quart d’hectare par ménage), la principale ressource. Celle-ci est basée sur la culture du palmier dattier de variété « Deglet Nour », assurant une production de haute valeur marchande destinée en partie à l’exportation. L’élevage extensif sur parcours, camelin en particulier, est en voie de régression. Les anciens nomades ont dû non seulement s’adapter à la vie sédentaire de l’oasis, mais aussi intégrer dans le même temps leurs systèmes de production à l’économie de marché. Dans l’ensemble, leur transformation en agriculteur oasien est estimée réussie et avantageuse: intégration des cultures fourragères et vivrières; travaux d’irrigation, d’entretien et de protection contre l’ensablement convenablement réalisés... Toutefois, la superficie agricole et les quantités d’eau disponibles s’avèrent insuffisantes pour assurer un revenu convenable à la population. La création d’un nouveau forage est en cours. En attendant, le sous-emploi est important dans l’oasis.
Permanence et évolution des comportements énergétiques
Nous avons vu l’importance des changements survenus dans l’économie et, d’une manière plus générale, dans le mode de vie des habitants d’El Faouar en un laps de temps relativement court (moins d’une génération). Examinons de plus près l’évolution des comportements énergétiques (techniques de cuisson et de chauffage, modes d’approvisionnement en combustible), lesquels sont révélateurs du changement dans les relations qu’entretiennent les nouveaux oasiens avec la steppe prédésertique.
Nous décrivons d’abord brièvement le comportement énergétique des nomades.Il nous servira de référence pour apprécier l’évolution en cours. Sous la tente, le foyer ouvert «trois pierres» est principalement utilisé pour la cuisine ainsi que pour la cuisson des galettes de pain (ftaira, marfousa, metloua…) dans un poêlon de terre. Le pain cuit sous la braise à même le sable (Khobs mella) est fréquemment préparé au désert. Chez les nomades, le four à pain est absent et la consommation de gaz ou de pétrole très faible, compte tenu notamment des difficultés d’approvisionnement. La femme pourvoit la tente en combustible par prélèvement direct sur la végétation environnante, usant d’une connaissance intime des plantes et des ressources végétales au gré des saisons et des itinéraires de transhumance. La répartition du travail entre les sexes est rigoureuse. La corvée de bois comme la préparation des aliments sont des activités féminines. Le comportement énergétique des nomades apparaît donc d’une grande rusticité, adapté à la sobriété des habitudes alimentaires et étroitement dépendant de l’environnement saharien.
Une enquête récente complétée par une série d’entretiens nous permet d’apprécier l’évolution rapide des comportements énergétiques à El Faouar. Aujourd’hui, la consommation de gaz GPL permet de couvrir la plus grande partie des besoins de cuisson. La consommation moyenne par ménage est importante (245 kg/an). La quasi-totalité des familles disposent d’un réchaud ou d’une cuisinière moderne à gaz; le régime alimentaire se transforme, avec notamment l’importance croissante des légumes et des pâtes. Le bois n’est plus guère utilisé que pour la cuisson quotidienne des galettes de pain (ftaira) sur le foyer « trois pierres », ainsi que pour la préparation hebdomadaire (le vendredi) du traditionnel « khobs el mella », le pain de sable cuit sous la braise. La cuisson familiale du pain est le principal poste de consommation de bois, ce que confirme le faible niveau des ventes de l’unique boulanger d’El Faouar. La consommation moyenne d’un ménage est estimée, en fonction des besoins et de la fréquence des approvisionnements, à deux tonnes de bois de feu par an, ce qui correspond, pour comparaison, à moins de la moitié de la consommation enregistrée dans le Nord-Ouest tunisien.Il est à noter que la biomasse agricole et les palmes de dattier ne sont guère utilisées que pour l’allumage du feu. Si la consommation de bois apparaît relativement modeste, il n’en est pas de même pour celle de charbon de bois qui atteint, pour les ménages utilisateurs (55% de l’ensemble), 350 kilos par an. Le charbon est utilisé dans les braseros traditionnels pour la préparation quotidienne du thé et surtout pour le chauffage en hiver. Notons, pour clore cet aperçu sur l’énergie domestique, que la plupart des familles sont aujourd’hui reliées au réseau électrique national.
La quasi-totalité du bois de feu consommé à El Faouar provient de la steppe périphérique. La plupart des ménages collectent directement le combustible, 20% l’achètent à des revendeurs de l’oasis. Concernant l’approvisionnement en bois, l’évolution des comportements est aussi notable. D’après les témoignages, il y a encore une dizaine d’années, les groupes de femmes assuraient la récolte dans la steppe par charges portées. Aujourd’hui, les petites charrettes légères tractées par des équidés sont principalement utilisées. L’épouse ne récolte le bois que dans 28% des ménages. Cette tâche est désormais confiée aux hommes et aux jeunes garçons, évolution qui traduit la raréfaction du combustible et le surcroît de distance à parcourir. En effet, une journée de travail est aujourd’hui nécessaire pour ramener un chargement de bois, deux jours si l’on désire un combustible de meilleure qualité. L’approvisionnement d’un ménage nécessite en moyenne cinq à six voyages pendant les mois d’hiver.
Les techniques de collecte n’ont guère changé. On coupe çà et là des brins vifs à l’aide de serpes ou de hachettes sans pratiquer de coupe à blanc sur la végétation clairsemée. À proximité de l’oasis, le seul combustible disponible en relative abondance est fourni par les souches de  Limoniastrum guyonianum mortes suite à la surexploitation et à la sécheresse. Il est alors nécessaire d’extraire le bois à la pioche, les parties souterraines fournissant un meilleur combustible que les parties aériennes.
Limoniastrum guyonianum mortes suite à la surexploitation et à la sécheresse. Il est alors nécessaire d’extraire le bois à la pioche, les parties souterraines fournissant un meilleur combustible que les parties aériennes.
Les zones exploitées pour le combustible sont des terres de parcours de statut collectif non soumises au régime forestier (les tribus et fractions tribales sont les personnalités juridiques détentrices du droit de propriété). L’accès aux ressources dépend encore étroitement de la généalogie et de l’appartenance tribale. Les familles Ghrib utilisent les parcours situés au nord et à l’ouest de l’oasis, les Essabria se dirigeant vers l’est et le sud.
Charbonnages au Sahara
L’intégralité du charbon de bois consommé par les ménages provient, comme le bois de feu, de la steppe. La consommation d’El Faouar est de l’ordre de 250 tonnes de charbon par an, correspondant à l’exploitation annuelle d’un millier de tonnes de bois. Mais le plus étonnant est de constater qu’El Faouar et les oasis voisines (Bechi, Sabria, Ghidma…) « exportent » du charbon de bois en direction des localités du Nefzaoua, de Douz à Jemma, Kebili et Souk El Had. Le désert pourvoit le Nefzaoua en combustible !
Il s’agit de filières clandestines, car le charbonnage au Sahara est une activité illicite et sévèrement réprimée par le service forestier. De ce fait, il est bien difficile d’estimer les flux en présence. D’après un entretien avec le responsable du service forestier d’El Faouar, une cinquantaine de charrettes pratiquent le charbonnage de manière intensive pendant les mois d’hiver. La moyenne des quantités de charbon saisies au cours des cinq dernières années est de l’ordre de 30 tonnes par an, mais les charbonniers du désert échappent facilement à la surveillance du forestier. On peut estimer (avec les précautions d’usage) la production des charbonniers d’El Faouar à environ 500 tonnes par an, dont la moitié environ serait commercialisée au gré à gré dans l’oasis, et l’autre moitié écoulée dans différents points de vente du Nefzaoua.
Le charbonnage concerne principalement les jeunes hommes de familles disposant des revenus agricoles les plus faibles. Cette activité est aussi l’occasion de renouer des relations intimes avec le désert, relations idéalisées et souhaitées par de nombreux jeunes oasiens. Le charbonnage nécessite en effet de longs déplacements à dos de chameau ou avec une charrette légère. La production de 500 kilos de charbon nécessite un travail de 12 à 15 jours dans le Sahara pour une petite équipe de charbonniers. On a mentionné des traces de carbonisation à plus de 50 kilomètres d’El Faouar, en plein erg. Les stations les plus recherchées sont les peuplements de  Calligonum comosum et
Calligonum comosum et  Calligonum azel, essences sahariennes qui fournissent le bois le plus dense et le charbon de meilleure qualité.
Calligonum azel, essences sahariennes qui fournissent le bois le plus dense et le charbon de meilleure qualité.
Le revenu tiré de cette activité est loin d’être marginal. Compte tenu d’un prix de vente moyen de 0,4dinar tunisien (DT) par kilo, le charbonnage peut rapporter un revenu annuel de 1.000 à 1.500 Dinards tunisiens par personne, à comparer avec le revenu moyen dégagé par un quart d’hectare de dattiers « Deglet Nour » en production, environ 3000 DT. Les oasis du Nefzaoua, éloignées des zones productrices du littoral (olivier) et du nord-ouest, sont caractérisées par une importante demande en charbon et des prix de vente élevés pour les filières conventionnelles. Dans ce contexte, et après l’arrêt des importations libyennes, les filières clandestines de charbonniers du désert ont de belles années devant elles même si, d’après certains témoignages, l’activité a régressé notablement depuis une vingtaine d’années. Le charbonnage constitue toujours une activité saisonnière et rémunératrice des plus importantes pour la frange oasienne la plus défavorisée, parfaitement intégrée dans des stratégies familiales largement basées sur la flexibilité et la pluri-activité.
Les conséquences écologiques, la désertification
Le charbonnage et l’approvisionnement domestique en bois de feu nécessitent l’exploitation annuelle de près de 4.000 tonnes de combustible dans la steppe environnant El Faouar, quantité largement supérieure aux potentialités de production et incompatible avec la préservation de la végétation arbustive; 65% de l’espace est constitué par des zones nues d’origine anthropique ou édaphique (chotts et ergs). La végétation ligneuse, dont le recouvrement n’excède pas 22% dans le meilleur des cas (en moyenne 6,6%), est localisée principalement sur les niveaux dunaires anciens en lisière des dépressions salées. Compte tenu de la productivité moyenne en biomasse de l’étage saharien supérieur (150 kg/ha/an), les prélèvements de combustible de la population d’El Faouar nécessiteraient l’exploitation annuelle de près de 250 kilomètres carrés de steppe... Depuis la sédentarisation des nomades il y a une vingtaine d’années, on assiste à la progression d’une auréole de désertification et à l’éradication des espèces sahariennes les plus utilisées pour le charbonnage.
La réalisation de transects à partir de l’oasis, sur lesquels sont portées régulièrement les caractéristiques de la végétation (espèces présentes, recouvrement, nombre de souches vivantes et détruites…), a montré que certaines espèces arbustives telles Calligonum azel et Calligonum comosum ont disparu dans un rayon de 25 kilomètres autour d’El Faouar. Seuls quelques îlots d’ Ephedra alata, subsistent dans les zones les plus difficiles d’accès (barkhanes). Limoniastrum guyonianum, halophyte caractérisée par une régénération naturelle importante, est l’espèce la plus abondante, mais le nombre de touffes ayant un brin de diamètre supérieur à 5 centimètres est compris entre 10 et 20 %, ce qui montre une forte pression de coupe.
Ephedra alata, subsistent dans les zones les plus difficiles d’accès (barkhanes). Limoniastrum guyonianum, halophyte caractérisée par une régénération naturelle importante, est l’espèce la plus abondante, mais le nombre de touffes ayant un brin de diamètre supérieur à 5 centimètres est compris entre 10 et 20 %, ce qui montre une forte pression de coupe.
Le schéma global d’exploitation des arbustes à El Faouar est le suivant: à une distance inférieure à 4 kilomètres de l’oasis, la végétation ligneuse est relativement épargnée et les traces d’exploitation anciennes. La surveillance importante du service forestier dans cette zone en est probablement la cause. Entre 4 et 10 kilomètres, la coupe est fréquente et intense mais peu de souches sont entièrement détruites. Les arbustes sont exploités pour l’approvisionnement domestique en bois de feu, par coupe de brins à la hache. Entre 10 et 15 kilomètres, la coupe de brins diminue et la coupe à blanc-étoc des souches pour la carbonisation commence à apparaître. Au-delà de 15 kilomètres, le charbonnage est seul responsable de la destruction de la végétation.
Les espèces les plus utilisées (Limoniastrum guyonianum,  Arthrophytum schmittianum,
Arthrophytum schmittianum,  Retama raetam) sont les plus abondantes; alors que celles qui sont préférées comme combustible (Calligonum azel, Calligonum comosum, Ephedra alata ssp. alenda) ont pratiquement disparu. L’abondance des espèces arbustives apparaît donc étroitement liée à leur qualité combustible et à l’usage sélectif des oasiens. On peut en déduire le schéma suivant, précisant l’ordre d’éradication des principales espèces arbustives :
Retama raetam) sont les plus abondantes; alors que celles qui sont préférées comme combustible (Calligonum azel, Calligonum comosum, Ephedra alata ssp. alenda) ont pratiquement disparu. L’abondance des espèces arbustives apparaît donc étroitement liée à leur qualité combustible et à l’usage sélectif des oasiens. On peut en déduire le schéma suivant, précisant l’ordre d’éradication des principales espèces arbustives :
- Calligonum ssp
- Ephedra alata
- retama raetam
- Limoniastrum guyonianum
- Athrophytum ssp et autres chaméphytes
La politique de sédentarisation victime de son succès
La politique de sédentarisation des nomades, avec la création de forages et de périmètres irrigués, a connu un succès remarquable dans le sud du Nefzaoua. Aujourd’hui, la population transhumante est résiduelle et l’essentiel de l’activité repose sur la production dattière. En s’intégrant rapidement à l’espace national et à l’économie de marché, les anciens nomades ont fait preuve de grandes qualités d’adaptation. Cette évolution s’est accompagnée de l’élévation notable de la plupart des indicateurs de développement (consommation, logement, scolarisation...)
Cependant, pour que ce développement (au sens le plus classique du terme) atteigne le niveau d’un développement durable, plusieurs défis sont à relever en matière de gestion des ressources naturelles. L’exploitation accrue de l’eau d’irrigation et du bois dans le cadre de filières parfaitement intégrées à l’économie de marché (la production dattière et le charbonnage) est en effet responsable de nouvelles menaces écologiques. Avec la croissance rapide de la population sédentaire, les surfaces irriguées loties par l’État se sont révélées insuffisantes. Les nouveaux oasiens ont répondu par la multiplication de forages illicites et par l’extension des surfaces plantées en dattier « Deglet Nour ». Ainsi, dans l’oasis de Nouïel, voisine d’El Faouar, la palmeraie lotie officiellement (97ha) n’occupe plus qu’une place marginale dans l’organisation d’un espace agricole irrigué qui comprend 650 hectares d’extension illégale. L’exploitation croissante de l’eau d’irrigation conduit au rabattement de la nappe souterraine du complexe terminal et souligne l’urgence d’une gestion soutenable des ressources hydriques. De même, le développement des filières de commercialisation de charbon de bois compromet le renouvellement des ressources ligneuses et favorise la désertification. Dans les deux cas, l’État semble impuissant à concevoir des mécanismes régulateurs sur des activités illégales d’une grande importance dans l’économie régionale. Les ressources naturelles paient en quelque sorte le prix de la paix sociale, victimes du remarquable succès de la politique de sédentarisation et de l’intégration massive des anciens nomades à l’économie de marché. Dans ce contexte, on peut se demander si la désertification est un phénomène si inquiétant aux yeux de la population locale. Le désert se vend bien dans le contexte d’un tourisme saharien en plein essor et une oasis cernée par les sables ne bénéficie-t-elle pas d’une incontestable plus-value touristique ?
Conclusion
Les comportements énergétiques présentent donc à la fois une évolution rapide et notable (consommation importante de gaz et de charbon de bois, changement dans la répartition du travail entre les sexes et dans les modes de transport du combustible) et une certaine permanence (cuisson traditionnelle du pain, utilisation exclusive de la végétation steppique, techniques de collecte et modes d’accès aux ressources inchangés). L’évolution constatée est à mettre en relation avec la raréfaction croissante du combustible à proximité de l’oasis. Il faut souligner la mauvaise valorisation des palmes et résidus agricoles, sous-utilisés faute de techniques adaptées, alors que la végétation steppique doit faire face à une forte pression sans qu’apparaissent des modes de gestion endogènes capables de réguler les prélèvements.
Concernant l’approvisionnement domestique en bois de feu, des actions simples permettant de réduire les prélèvements sont prometteuses dans le contexte d’un habitat groupé et d’une demande constituée principalement par la cuisson familiale du pain: l’installation de boulangeries ou de fours communautaires adaptés. Ce type d’action est programmé en milieu rural. Il s’avère intéressant à expérimenter dans le sud du Nefzaoua, dans la mesure où il pourrait être ultérieurement, et de manière préventive, transposé dans le cadre de l’ambitieux projet de bir redjem Maatoug, lequel prévoit la création de 2000 hectares de palmeraie près de la frontière algérienne. Concernant les filières illicites de charbonnage, les solutions techniques ne peuvent être suffisantes tant ce phénomène est lié au contexte social et économique régional (niveau de l’emploi et des revenus agricoles).
Quelques éléments d'information sur les nomades Rebaiya du sud saharien tunisien
D'après un article de Terres des hommes
Les Rebaiya
 "../..l'Erg n'est pas totalement abandonné, car des campements Rebaiya assez nombreux y séjournent encore, nomadisant de part et d'autre de la frontière algéro-tunisienne. Ils sont de nationalité algérienne et sont les descendants des envahisseurs Hilaliens (milieu du XIe siècle), tout comme bon nombre des célèbres Chaamba. Ils vivent très simplement, soit, en été, non loin des puits, dans des zéribas (huttes) de branches et de graminées séchées, soit dans des abris à peine recouverts d'un morceau de toile ou de quelques branchages, plus rarement sous la tente. Ils élèvent chamelles, chèvres et moutons. Leurs chiens sont des sloughis, petits lévriers arabes très rapides, capables d'attraper lièvres et même gazelles à la course. Ces nomades Rebaiya ont l'habitude de traverser l'Erg pour vendre leurs animaux sur les marchés du Nefzaoua (Sabria, Douz) ou pour rechercher des pâturages, à l'est, vers Dekanis, Bir Aouine, Aïn Zegaba ou même beaucoup plus au sud, vers El Borma, la grande station de pétrole tunisienne, et Bordj El Khadra. Ils ont aussi des contacts assez fréquents avec les oasis de la région d'El Oued, en Algérie, dont ils dépendent. Ils vivaient autrefois en Tripolitaine qu'ils ont quittée il y a environ 200 ans, pour s'installer dans le Souf (Algérie). "
"../..l'Erg n'est pas totalement abandonné, car des campements Rebaiya assez nombreux y séjournent encore, nomadisant de part et d'autre de la frontière algéro-tunisienne. Ils sont de nationalité algérienne et sont les descendants des envahisseurs Hilaliens (milieu du XIe siècle), tout comme bon nombre des célèbres Chaamba. Ils vivent très simplement, soit, en été, non loin des puits, dans des zéribas (huttes) de branches et de graminées séchées, soit dans des abris à peine recouverts d'un morceau de toile ou de quelques branchages, plus rarement sous la tente. Ils élèvent chamelles, chèvres et moutons. Leurs chiens sont des sloughis, petits lévriers arabes très rapides, capables d'attraper lièvres et même gazelles à la course. Ces nomades Rebaiya ont l'habitude de traverser l'Erg pour vendre leurs animaux sur les marchés du Nefzaoua (Sabria, Douz) ou pour rechercher des pâturages, à l'est, vers Dekanis, Bir Aouine, Aïn Zegaba ou même beaucoup plus au sud, vers El Borma, la grande station de pétrole tunisienne, et Bordj El Khadra. Ils ont aussi des contacts assez fréquents avec les oasis de la région d'El Oued, en Algérie, dont ils dépendent. Ils vivaient autrefois en Tripolitaine qu'ils ont quittée il y a environ 200 ans, pour s'installer dans le Souf (Algérie). "
Lors d'un voyage en 2007, notre accompagnateur tunisien leur avait acheté un jeune bouc pour le méchoui du soir, et deux d'entre eux s'étaient invités, comme le permet la coutume d'hospitalité au désert.
Un peu plus tard, nous avons rejoint un campement où avait lieu un
mariage, en plein désert, probablement des Rebaiya.
L’Epopée du Marquis de Mores en Tunisie (1896)
D'après une conférence de l'amicale des enfants de Tunisie
Dreyfus, le boulangisme, le massacre de la mission Flatters et la résistance française à la pénétration anglaise au Soudan, l’aventure malheureuse du Marquis de Morés en est un passionnant reflet.
Ancien officier de Saint Cyr, il quitte l’armée en 1882 pour se lancer dans l’élevage aux Etats Unis, puis se rend en Indochine pour y étudier la création de lignes de chemins de fer au Tonkin. Ulcéré par les luttes d’influence qu’il y constate, il revient à Paris avec un objectif: combattre le parlementarisme qui est au service de la France cosmopolite représentée par le juif et le franc maçon. Il se veut solidaire du peuple suivant l’encyclique de Léon XIII.
Début 1893, après avoir étripé en duel et avoir été assigné en justice par ses adversaires, il quitte la politique et se tourne vers l’Afrique où il veut combattre l’hégémonie anglaise.
Il fonde à Alger en 1894, le parti antisémite algérien et parcourt le pays pour approfondir sa connaissance sur les pays musulmans. Il croit comme Duveyrier et le duc de Polignac à l’appui des confréries religieuses et des touaregs à la cause française et conçoit le projet chimérique de lever une armée arabe de 20 000 hommes encadrée d’officiers français pour reprendre aux anglais le Soudan et la Haute Egypte avec l’aide des Tidjanias et des Senoussias.
En vue de ce projet, il décide d’aller lui-même à Ghadamès, à Ghat et à Koufra rencontrer les chefs de ces confréries.
Débarquant à Tunis en mars 1896, il essaye de convaincre du bien fondé de son projet le résident général Millet et son conseiller militaire Rebillet. Le premier, bien qu’arabophile et le second peu enclin à favoriser une telle expédition qui contrecarre des projets personnels ne l’encouragent point et lui demandent d’éviter la frontière tuniso tripolitaine peu sûre et de passer le sud algérien. Morès persiste dans son idée et recrute à Tunis interprète, guides et domestiques. Il achète la collaboration d’un négociant de Ghadamès et s’embarque avec tout ce monde pour Gabès. Il y recrute des chameaux avec leurs chameliers et c’est un convoi de 29 personnes qui arrive à Kébéli, mais beaucoup parmi ses compagnons sont surtout attirés par l’argent que le marquis porte sur lui. Contrairement à ce qu’il a promis, il se dirige vers la frontière tunisienne et à Djeneïen renvoie la plupart de son personnel tunisien pour s’entourer de touaregs qu’il croit favorables à la France. Egaré par ces derniers, il est attaqué par eux le 6 juin 1896 à l’aube au lieu dit El Ouatia sur la ligne frontalière. Malgré une résistance héroïque de plusieurs heures, il est finalement abattu, dévalisé de son or et de ses affaires et laissé sur le terrain. Quelques-uns de ses compagnons tunisiens sont massacrés avec lui.
Dès la nouvelle, l’affaire fait grand bruit à Tunis et à Paris où ses obsèques solennelles sont célébrées en présence des représentants du gouvernement. Sa veuve, qui a aussitôt déclenché une enquête pour retrouver les assassins passés en Tripolitaine, est aidée d’amis de son mari de même obédience. Les trois assassins sont arrêtés en Tripolitaine et ramenés en Tunisie, par contre le caïd de Kebili, fortement impliqué n’est pas inquiété. Jugés au tribunal de Sousse, l’un d’eux est condamné à mort, puis il est gracié à la demande de Madame de Morès, sa peine étant transformée en travaux forcés à perpétuité. Le lieutenant Leboeuf, commandant le cercle de Kebili, est traduit en justice puis relaxé. Millet et Rebillet, qui attaqués ont introduit une requête en diffamation, sont blanchis, mais le premier est rappelé en France et le second est mis à la retraite. L’alliance franco-anglaise, malgré cette affaire et l’aventure de Fachoda en 1898, se maintenait au grand soulagement des membres du gouvernement français.
Une courte notice figure à la page « patrimoine » de la ville de Cannes (de Morès y est enterré)
" Marquis de Morès (1858-1896)
Il est issu de la très vieille noblesse des Vallombrosa. Brillantes études au collège Stanislas qui vient d’ouvrir ses portes à Cannes, puis à Saint-Cyr. Mariage à l’église Sainte-Marguerite avec Médora de Hoffman, dont le père, riche banquier new-yorkais, vient d’acquérir le château de La Bocca. Sa personnalité le pousse à préférer la vie d’aventurier à celle de châtelain : Antoine de Morès devient éleveur dans le Far West américain, tente d’ouvrir une ligne de chemin de fer au Tonkin, puis, de retour à Paris, épouse la cause des déshérités et se range sous la bannière de l'anarchisme. Mais un nouveau projet germe dans son esprit : rallier toutes les tribus nomades du Soudan afin de constituer un grand empire musulman allié à la France (avec l’arrière-pensée de prendre les Anglais à revers en remontant jusqu’aux sources du Nil). Il monte son expédition en dépit de toutes les oppositions, tant familiales que gouvernementales. Après neuf jours de traversée du désert, alors qu’il franchit la colline d’El-Ouatia, il tombe dans une embuscade dressée par les Touaregs de son escorte et succombe devant le nombre des ennemis. Une destinée hors du commun../.."